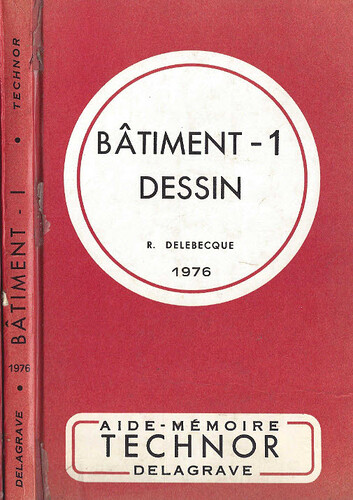Manuel de Référence du Dessin Technique traditionnel de Bâtiment
1.0 Principes Fondamentaux et Équipement du Dessinateur
La production de documents graphiques dans le secteur du bâtiment exige une rigueur et une précision absolues. Chaque plan, coupe ou détail constitue un ordre d’exécution qui ne laisse aucune place à l’interprétation. La maîtrise des équipements de base et des principes fondamentaux du dessin n’est donc pas une simple formalité, mais le socle indispensable sur lequel repose la qualité, la lisibilité et l’exploitabilité de toute production technique. C’est en maîtrisant ces fondamentaux que le dessinateur garantit une communication claire et univoque entre la conception et la réalisation.
1.1 Analyse de l’Équipement Essentiel
L’exécution de dessins techniques de qualité professionnelle repose sur l’utilisation d’outils adaptés, chacun remplissant une fonction précise pour garantir la netteté et l’exactitude des tracés.
- La planche à dessin : Elle doit être parfaitement plane et de dimensions suffisantes (formats courants : 55x80 cm, 80x110 cm, 110x160 cm). Elle constitue le support stable pour le travail.
- Le té : Cet instrument permet le tracé des parallèles. Simple ou articulé pour le tracé d’obliques, il glisse le long du bord de la planche et sert de guide pour les équerres. Sa rectitude doit être parfaite.
- La règle graduée : Essentielle pour les mesures, elle est généralement graduée en centimètres et millimètres. Elle permet de reporter les dimensions avec précision.
- Les équerres : Les modèles à 45° et à 60° sont les plus courants. Elles permettent de tracer des perpendiculaires et des angles standards en s’appuyant sur le té.
- Les pistolets (ou courbes) : Ils sont utilisés pour tracer des courbes complexes qui ne peuvent être réalisées au compas.
- Le compas : Indispensable pour tracer des cercles et des arcs de cercle. Les modèles de précision sont dotés d’une rallonge pour les grands cercles.
- Les gabarits : Ces outils pré-perforés permettent de tracer rapidement et de manière normalisée des formes récurrentes (symboles, sanitaires, mobilier, lettres).
- Le rapporteur : Il sert à tracer et à mesurer des angles, avec un rayon minimum de 80 à 100 mm pour une bonne précision.
- Le porte-mine et les mines : Le porte-mine est l’outil de tracé principal. On utilise différentes duretés de mine (de 3H à 5H) selon le support (calque ou papier) pour obtenir un trait fin et régulier. Le porte-mine à mine calibrée (0,5 mm) est également courant.
- L’encre de Chine et les tire-lignes : Pour l’encrage final des dessins, on utilise l’encre de Chine en cartouche ou en bouteille. Le tracé est réalisé avec des porte-plumes à réservoir (type « Graphos ») ou des stylos à pointe tubulaire (type « Rapidograph »), qui offrent différentes épaisseurs de trait.
- Matériel d’effaçage : Des gommes tendres sont utilisées pour effacer les traits au crayon, tandis que le grattoir à lame fine permet des retouches de précision sur les traits à l’encre.
1.2 Maîtrise des Supports et Techniques de Préparation
La préparation du support est une étape cruciale qui conditionne la qualité du dessin final. Le travail industriel s’exécute généralement sur du calque, fixé sur un papier de fond blanc.
Deux méthodes principales permettent de fixer le papier sur le calque :
- Par collage : En utilisant une bande de papier adhésif qui est tendue en séchant. Cette méthode nécessite un papier d’un grammage élevé (environ 200 g/m²).
- Par punaises ou bande adhésive : Solution plus simple, elle consiste à tendre le papier et le calque sur la planche à dessin. Pour cette méthode, un papier de 120 g/m² est suffisant. On utilise généralement un papier calque de 90 g/m².
Une fois le support préparé, plusieurs techniques graphiques entrent en jeu :
- Le tracé au crayon : C’est la première étape de la construction du dessin. Il doit être précis et léger pour permettre des corrections.
- L’encrage : Il s’agit de repasser les traits définitifs à l’encre de Chine pour garantir une lisibilité et une reproductibilité parfaites.
- Le lettrage : Les inscriptions (titres, cotes, légendes) doivent être réalisées avec soin, souvent à l’aide de gabarits, pour assurer une clarté irréprochable.
- Le laçis : Cette technique consiste à appliquer des trames adhésives découpées pour représenter des matériaux ou des zones spécifiques, offrant un rendu net et homogène.
- L’aquarelle : Utilisée pour appliquer des teintes conventionnelles, elle permet de différencier des zones (démolition, construction) ou de donner du relief aux façades. Elle demande une certaine habileté pour éviter de déformer le support.
1.3 Classification et Finalité des Différents Types de Dessins
Chaque type de dessin dans un projet de bâtiment répond à un objectif spécifique et présente un niveau de détail adapté à sa fonction.
| Type de Dessin |
Objectif et Niveau de Détail |
| Croquis |
Dessin exécuté à main levée. Il sert à représenter une idée générale ou un relevé rapide sur le terrain. |
| Esquisse |
Dessin à petite échelle, exécuté à main levée dans la phase de recherche des grandes lignes d’un projet. |
| Étude |
Dessin à l’échelle, exécuté avec soin, qui analyse en détail un ensemble, un appareil ou une solution constructive. |
| Schéma |
Dessin simplifié, à l’échelle ou non, qui représente les liaisons fonctionnelles d’un ensemble (installations, etc.). |
| Avant-projet |
Ensemble de dessins qui établit les dispositions générales d’un bâtiment et fournit les renseignements nécessaires aux entrepreneurs. |
| Plan de situation |
Situe un terrain dans son quartier, sa ville. Exécuté à petite échelle (ex: 1/5000). |
| Plan de masse |
Situe un projet sur son terrain. Exécuté à petite échelle (ex: 1/200). |
| Perspective |
Dessin figuratif en trois dimensions, suivant des règles géométriques (axonométriques ou coniques). Peut être ombrée ou teintée. |
| Épures |
Constructions géométriques qui servent à déterminer des formes exactes, notamment pour les tracés de charpente. |
1.4 Standardisation de la Présentation des Dessins
Une présentation normalisée est essentielle pour que les différents intervenants d’un projet puissent lire et comprendre les plans rapidement et sans ambiguïté.
- Dispositions des Vues :
- Les plans d’un même étage (ex: rez-de-chaussée) et les coupes associées sont regroupés sur une même feuille ou sur des planches séparées.
- Les façades et les coupes sont groupées pour faciliter la consultation.
- Les coupes partielles et les sections de détail sont placées à proximité de la vue d’ensemble correspondante pour une référence aisée.
- Orientation géographique : Une rose des vents est systématiquement dessinée sur les plans pour indiquer le Nord, conformément à la norme NF P 02.002.
- Structure du Cartouche : Le cartouche est la carte d’identité du plan. Il est généralement placé dans un angle de la feuille, à un endroit où il reste visible après pliage. Il doit contenir les inscriptions obligatoires suivantes :
- Désignation et adresse de la construction.
- Nom et adresse du propriétaire.
- Désignation ou repérage de la partie considérée (plan, coupe, façade).
- Désignation du corps d’état.
- Échelle numérique et graphique.
- Liste des dessinateurs.
- Nom, adresse et signature de l’architecte.
- Emplacements pour les visas.
- Tableau pour noter les modifications.
- Numéro de classement ou de référence de l’architecte.
- Emplacement pour références et autres indications légales.
- Système de Repérage : Pour naviguer efficacement dans un projet, un système de repérage codifié est mis en place :
- Repérage des étages : Chaque niveau est identifié (ex: Sous-sol, R. de chaussée, 1er étage). Le niveau d’entresol est noté « En ».
- Repérage des locaux : Au sein d’un étage, chaque local est désigné par un numéro unique, souvent dans le sens des aiguilles d’une montre.
- Repérage des travées : Dans les constructions à ossature, les files de poteaux sont repérées par des lettres dans un sens et des chiffres dans l’autre (ex: repère A-B-3-4).
- Repérage des escaliers : Les marches sont numérotées dans l’ordre de la montée, en partant du palier de départ.
- Formats et Pliages Normalisés : L’utilisation de formats standards et d’un pliage normalisé facilite l’archivage, la consultation et la reproduction des documents. Le pliage est effectué pour ramener le document au format A4 (210 x 297 mm), en laissant le cartouche visible.
| Type de Plan |
Échelles Recommandées |
Formats Standards |
| Plan de situation |
1/5 000, 1/2 000 |
A0 : 841 x 1189 mm |
| Plan de masse |
1/500, 1/200, 1/100 |
A1 : 594 x 841 mm |
| Plan d’ensemble |
1/200, 1/100, 1/50 |
A2 : 420 x 594 mm |
| Plan d’exécution |
1/50, 1/20, 1/10 |
A3 : 297 x 420 mm |
| Détails |
1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1 |
A4 : 210 x 297 mm |
La maîtrise de ces règles de présentation constitue la première étape vers des plans clairs et professionnels. Elle doit être complétée par une application rigoureuse des conventions graphiques qui forment le langage commun de tous les techniciens du bâtiment.
2.0 Conventions Essentielles de Représentation Graphique
En dessin technique, chaque trait, chaque hachure et chaque symbole possède une signification précise et universelle. Ces conventions graphiques forment un langage normalisé, indispensable pour garantir que l’intention du concepteur soit comprise sans la moindre ambiguïté par tous les corps de métier sur le chantier. Le respect de ce langage est la meilleure garantie contre les erreurs d’interprétation, les malfaçons et les retards qui peuvent en découler.
2.1 Analyse des Types de Traits et Leurs Applications
La norme NF P 02-001 définit une hiérarchie de traits qui permet de distinguer visuellement les différents éléments d’un dessin et d’en faciliter la lecture. L’épaisseur des traits (forts, moyens, fins) est choisie en fonction de l’échelle et de la complexité du dessin.
Typologie des Traits et Leurs Applications
| Type de Trait |
Usage Normalisé |
| Continu fort |
Sections vues, traits de niveau de sol, cadres et cartouches. |
| Continu moyen |
Arêtes et contours apparents, courbes de niveau principales, seuils, marches, escaliers. |
| Continu fin |
Lignes de cote, lignes de rappel, hachures, contours de sections rabattues, fonds de plans, arêtes fictives. |
| Interrompu fort |
Contours et arêtes cachés, tuyauteries cachées, représentation de parties à démolir. |
| Interrompu moyen |
Contours et arêtes cachés, lignes électriques. |
| Interrompu fin |
Contours et arêtes cachés, certaines hachures. |
| Mixte fort |
Traces des plans de coupe et de section. |
| Mixte moyen |
Axes principaux des plans de symétrie, lignes d’éléments de construction, axes d’ossatures et d’implantation. |
| Mixte fin |
Axes secondaires de toutes natures, ossatures. |
| Mixte fin à 2 points |
Tracés des alignements. |
La hiérarchie des grosseurs est généralement la suivante : Trait fort = 1, Trait moyen = 0,5 trait fort, Trait fin = 0,25 trait fort.
2.2 Normes d’Écriture et de Lettrage
Selon la norme NF P 02-004, l’écriture sur un dessin technique doit être avant tout lisible, homogène et adaptée à la reproduction.
- Principes généraux : Les caractères doivent être simples et réguliers. L’emploi indifférencié de majuscules ou de minuscules est recommandé pour les titres et les indications manuscrites.
- Caractéristiques dimensionnelles : La hauteur des caractères est normalisée et varie en fonction de leur importance sur le dessin (titres, cotes, textes). L’épaisseur du trait est proportionnelle à la hauteur du caractère (environ 1/10e de la hauteur).
- Écriture droite ou inclinée : L’écriture peut être verticale (droite) ou inclinée à 75° par rapport à l’horizontale. L’écriture inclinée est souvent perçue comme plus rapide à exécuter et plus dynamique, tandis que l’écriture droite offre une apparence plus formelle et stable. Le choix est souvent une question de préférence, mais la cohérence doit être maintenue sur un même jeu de plans.
2.3 Utilisation des Hachures et Teintes Conventionnelles
Les hachures et les teintes sont des outils graphiques puissants pour clarifier la nature des matériaux et les interventions prévues sur un projet.
- Principes Généraux :
- N’utiliser les hachures et teintes conventionnelles que dans les sections, afin de différencier les matériaux.
- Ne pas surcharger le dessin. Les hachures doivent être exécutées en traits fins.
- Si l’on crée des symboles ou des hachures non normalisés, le dessin doit obligatoirement comporter une légende claire.
- Codification des Matériaux :
| Matériau |
Hachure Conventionnelle (NF P 02-008) |
| Agglomérés et béton manufacturés |
Fond de points fins et réguliers. |
| Béton coulé, béton banché, dallage |
Triangles (gravier) et points (sable) sur fond blanc. |
| Béton armé |
Identique au béton coulé, avec une représentation possible des armatures réelles si l’échelle le permet. |
| Bois (coupe transversale) |
Représentation des cernes de croissance. |
| Bois (coupe longitudinale) |
Représentation des fibres du bois. |
| Briques en plan |
Hachures obliques doubles, espacées. |
| Matières isolantes |
Hachures en quadrillage oblique, avec un aspect « moelleux ». En faible épaisseur, poché noir. |
| Métaux |
Fines hachures obliques, parallèles et serrées. En faible épaisseur, poché noir. |
| Pierres et autres matériaux naturels |
Représentation schématique de l’appareillage de maçonnerie. |
- Usage des Teintes : Les teintes conventionnelles permettent de visualiser immédiatement la nature des travaux. Elles sont appliquées en lavis léger (aquarelle) pour ne pas masquer les autres informations du dessin.
- Jaune : Parties à démolir.
- Rouge : Parties à construire (maçonnerie, béton).
- Bleu : Parties métalliques en coupe.
- Hachures légères : Parties à conserver.
Une fois que ce « langage » graphique commun est maîtrisé, il devient possible de l’utiliser pour construire avec précision les formes géométriques qui constituent l’ossature de tout dessin de bâtiment.
3.0 Techniques de Tracés Géométriques
Les tracés géométriques constituent la grammaire du dessin technique, sa fondation mathématique. Avant de pouvoir représenter un bâtiment complexe, il est impératif de savoir construire avec une précision absolue les formes élémentaires qui le composent. La maîtrise de ces constructions géométriques est la garantie de l’exactitude des formes, de la justesse des angles et du respect des proportions dans tous les types de plans.
3.1 Constructions Fondamentales
Les constructions de droites et d’angles forment la base de la plupart des dessins techniques.
- Perpendiculaires et Parallèles : La capacité à tracer des droites parfaitement perpendiculaires et parallèles est fondamentale. Les méthodes incluent :
- Le tracé de la médiatrice d’un segment pour trouver son milieu et lui élever une perpendiculaire.
- Le tracé d’une perpendiculaire à une droite passant par un point donné (situé sur ou en dehors de la droite), en utilisant le compas.
- Le tracé de parallèles en s’appuyant sur le té et l’équerre, ou par construction géométrique au compas.
- Angles : La précision des angles est essentielle pour les assemblages et les orientations.
- Les angles standards (90°, 45°, 60°, 30°) sont obtenus directement avec les équerres ou par des constructions simples (bissectrice, triangle équilatéral).
- La bissectrice permet de diviser un angle en deux parties égales.
- Le report d’un angle consiste à reproduire un angle quelconque à un autre endroit du dessin à l’aide du compas.
- Divisions et Polygones : Ces techniques permettent de créer des formes régulières et de répartir des espaces.
- La division d’un segment en un nombre quelconque de parties égales se fait par une construction auxiliaire (méthode de la règle graduée ou de Thalès).
- La construction de polygones réguliers (triangle équilatéral, carré, pentagone, hexagone) s’effectue par des tracés au compas, souvent en inscrivant la figure dans un cercle.
3.2 Tracés des Courbes Complexes
Au-delà des cercles, de nombreuses formes architecturales et techniques font appel à des courbes plus complexes.
- Ellipse et Parabole : L’ellipse est une courbe fermée définie par deux points fixes (foyers). La parabole est une courbe ouverte définie par un foyer et une droite (directrice). Elles se tracent point par point ou à l’aide de méthodes spécifiques comme celle du parallélogramme pour l’ellipse.
- Hyperbole, Spirale et Volute : L’hyperbole est une courbe ouverte à deux branches, définie par la différence des distances à deux foyers. La spirale est une courbe qui s’enroule autour d’un centre en s’en écartant. La volute est une spirale formée d’arcs de cercle raccordés.
- Hélice et Ovale : L’hélice est une courbe tracée sur un cylindre, générée par un double mouvement de rotation et de translation. L’ovale est une courbe fermée, symétrique, composée d’arcs de cercle.
- Anse de panier, Arc rampant et Ogive : Ce sont des arcs spécifiques très utilisés en architecture. L’anse de panier est un arc surbaissé formé de plusieurs arcs de cercle raccordés (3 ou 5 centres). L’arc rampant est un arc asymétrique. L’ogive (ou arc brisé) est formée par la rencontre de deux arcs de cercle.
- Moulures : Ce sont des profils décoratifs (quart de rond, cavet, doucine, etc.) dont le tracé est une combinaison d’arcs de cercle et de droites.
- Raccordements et Tangentes : Les raccordements permettent de joindre deux lignes (droites ou courbes) par un arc de cercle sans rupture de continuité. La maîtrise du tracé des tangentes à un cercle est une condition préalable à la réalisation de raccordements parfaits.
3.3 Représentation des Intersections et Développements
La représentation correcte de l’intersection de volumes est cruciale dans des domaines comme la tuyauterie, la ventilation ou la tôlerie.
- Intersections de volumes : Le dessin technique permet de déterminer la ligne d’intersection entre deux solides (cylindres, cônes, sphères). La méthode consiste à trouver graphiquement les points communs aux deux surfaces. Les applications sont nombreuses : voûtes, trémies, raccordements de tuyauterie.
- Développements de solides : Le développement consiste à « déplier » la surface d’un volume pour l’obtenir en vraie grandeur sur un plan. Cette technique est indispensable pour fabriquer des objets en tôle ou en carton (prisme, cylindre, pyramide, cône) en traçant le patron qui sera ensuite découpé et plié.
La maîtrise de ces formes géométriques, des plus simples aux plus complexes, permet maintenant de les combiner pour représenter de manière rigoureuse des objets tridimensionnels comme un bâtiment, en utilisant des systèmes de projection normalisés.
4.0 Projections et Perspectives : Représentation Tridimensionnelle
Le défi majeur du dessin technique est de représenter un bâtiment, objet à trois dimensions, sur un support qui n’en a que deux : la feuille de papier. Pour résoudre ce problème et permettre une compréhension complète et sans ambiguïté du volume, les dessinateurs utilisent un ensemble de méthodes codifiées : les projections orthogonales pour la description technique précise (plans, coupes, façades) et les perspectives pour la visualisation globale.
4.1 Vues Usuelles et Projections Orthogonales
Le principe de la projection orthogonale consiste à imaginer l’objet placé au centre d’un cube transparent. On projette ensuite perpendiculairement les faces de l’objet sur les parois intérieures du cube. Enfin, on « développe » ou « déplie » ce cube pour obtenir les différentes vues sur un même plan.
Cette méthode normalisée définit la terminologie et la disposition des vues :
- Vue de face : La vue principale de l’objet.
- Vue de dessus : Placée sous la vue de face.
- Vue de gauche : Placée à droite de la vue de face.
- Vue de droite : Placée à gauche de la vue de face.
- Vue de dessous : Placée au-dessus de la vue de face.
- Vue arrière : Placée à l’extrémité droite ou gauche.
Cette disposition rigoureuse garantit que n’importe quel technicien interprétera les relations spatiales entre les vues de la même manière.
4.2 Les Plans : Vues en Coupe Horizontale
Un plan est une vue de dessus après avoir réalisé une coupe horizontale du bâtiment, généralement à 1 mètre au-dessus du sol du niveau considéré. Il permet de montrer l’organisation intérieure des espaces. Un plan complet doit impérativement figurer les éléments suivants :
- Les murs et cloisons : Représentés coupés, ils montrent la structure porteuse et la distribution des pièces.
- Les ouvertures : Les portes et fenêtres sont dessinées en indiquant leur emplacement et leur sens d’ouverture.
- Les escaliers : Ils sont représentés coupés au niveau du plan, avec une flèche indiquant le sens de la montée.
- Le mobilier : Des symboles normalisés de mobilier (lits, tables, sanitaires) sont souvent ajoutés à l’échelle pour permettre de juger de la fonctionnalité et de l’habitabilité des espaces.
- Les repères : Des indications claires repèrent l’emplacement des coupes verticales (ex: Coupe AA) et les niveaux d’altitude.
4.3 Les Coupes et Sections : Vues en Coupe Verticale
Alors qu’un plan est une coupe horizontale, les coupes et sections sont des vues en coupe verticale qui révèlent la structure interne, les hauteurs et les détails constructifs d’un bâtiment. Selon la norme NF E. 04.102, il est essentiel de distinguer ces deux notions.
- Coupes : Une coupe montre les éléments tranchés par le plan de coupe et les éléments visibles en arrière-plan.
- Rôle : Elles sont essentielles pour comprendre la composition des planchers, des toitures, la hauteur sous plafond, le passage des gaines, etc.
- Repérage : Une coupe est repérée sur le plan par un trait mixte fort indiquant sa position, avec deux lettres majuscules à ses extrémités et des flèches montrant le sens d’observation. Le dessin de la coupe est titré en conséquence (ex: « Coupe AA »).
- Conventions : Les parties coupées sont dessinées en trait fort et souvent hachurées selon le matériau. Les parties vues en arrière-plan sont dessinées en trait plus fin.
- Sections : Une section ne représente que les éléments situés dans le plan de coupe.
- Usage : Elle est utilisée pour montrer le profil exact d’un élément structurel ou d’une menuiserie (poutre, poteau, profilé de fenêtre). La section est systématiquement hachurée.
- Coupes Partielles : Lorsqu’il n’est pas nécessaire de dessiner une coupe complète du bâtiment, on peut utiliser une coupe partielle (ou « arrachement »). Elle permet de clarifier un détail de construction localisé (ex: un raccord de plancher, un linteau) de manière économique et efficace.
4.4 Les Façades : Vues Extérieures
Les façades sont les vues en élévation des faces extérieures d’un bâtiment. Elles ne comportent pas de coupe et ont pour but de montrer l’aspect architectural final du projet. Une façade bien représentée doit indiquer :
- L’aspect extérieur général et les proportions.
- Les matériaux de parement (briques, enduit, bardage) souvent suggérés par des textures graphiques.
- Les ouvertures (portes et fenêtres).
- Les principaux niveaux finis (planchers, toiture).
- L’orientation (ex: Façade Sud-Ouest).
Pour améliorer la lisibilité et la perception des volumes, les façades peuvent être agrémentées d’ombrages, de personnages ou de végétation pour donner une idée de l’échelle et du contexte.
4.5 Plans de Masse et de Situation
Ces deux plans situent le projet dans son environnement à différentes échelles.
- Plan de masse : Il représente le projet de construction sur sa parcelle. Il montre l’emprise au sol du bâtiment, les limites du terrain, les accès, les réseaux et les aménagements extérieurs. L’échelle est typiquement de 1/200 ou 1/500.
- Plan de situation : Il localise la parcelle dans son contexte plus large (quartier, commune). Il indique les voies de desserte, les bâtiments avoisinants et les repères géographiques importants. L’échelle est beaucoup plus petite, par exemple 1/2000 ou 1/5000.
4.6 Perspectives pour la Visualisation
Les perspectives sont des représentations en trois dimensions qui, contrairement aux projections orthogonales, donnent une vision plus réaliste et intuitive du volume du bâtiment.
| Type de Perspective |
Principes et Coefficients de Réduction |
Avantages et Usages Recommandés |
| Perspective Cavalière |
Une face est représentée en vraie grandeur, parallèle au plan de dessin. Les fuyantes (perpendiculaires à cette face) sont obliques (souvent 45°) et affectées d’un coefficient de réduction (ex: 0,5 ou 0,7). |
Simple et rapide à construire. Idéale pour représenter des pièces simples ou des schémas où la face avant est la plus importante. |
| Perspective Isométrique |
Les trois axes sont égaux (120° entre eux). Les longueurs portées sur ces axes sont affectées d’un même coefficient de réduction (0,82), mais on utilise souvent un rapport de 1 pour simplifier. |
Très utilisée pour les schémas techniques et les vues éclatées. Donne une vision équilibrée de l’objet sans déformation excessive d’une face par rapport aux autres. |
| Perspective Trimétrique |
Les angles entre les trois axes sont quelconques, et chaque axe a son propre coefficient de réduction. Une variante courante utilise des angles de 105°, 120° et 135°. |
Plus complexe à tracer mais offre une grande flexibilité. Permet de mettre en valeur un angle ou une vue spécifique du bâtiment et d’éviter la superposition de lignes. |
La représentation géométrique, aussi précise soit-elle, reste incomplète. Pour qu’un dessin soit exploitable sur un chantier, il doit être complété par des informations dimensionnelles claires et normalisées. C’est l’objet de la cotation.
5.0 Cotation, Modulation et Tolérances : La Précision Dimensionnelle
La cotation est l’opération qui consiste à indiquer sur un dessin toutes les dimensions nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre d’un ouvrage. Une cotation claire, complète et conforme aux normes est impérative pour traduire le projet graphique en réalité construite sans erreur ni ambiguïté. C’est le maillon essentiel qui garantit que les intentions du concepteur seront respectées au millimètre près sur le chantier.
5.1 Implantation et Niveaux
L’implantation dimensionnelle du bâtiment repose sur des principes de modulation et de repérage altimétrique.
- Règles de Modulation : Conformément à la norme NF P. 01.001, les cotes d’une construction doivent être, autant que possible, des multiples d’un module de base. Les modules couramment utilisés sont de 10 cm, 5 cm ou 2,5 cm. Ce principe de coordination modulaire facilite la préfabrication et la coordination entre les différents éléments de la construction.
- Cotation des Niveaux : Toutes les altitudes d’un projet sont exprimées en cotes cumulées par rapport à une origine unique : le niveau ± 0,00, qui correspond généralement au niveau du sol fini du rez-de-chaussée.
- Les niveaux des planchers (sol fini) sont indiqués par une flèche pointant vers le bas.
- Les niveaux des plafonds (sous face) sont indiqués par une flèche pointant vers le haut.
- Le symbole est un cercle avec une ligne horizontale, la moitié supérieure étant noircie. Les valeurs positives sont au-dessus du 0,00, les valeurs négatives en dessous.
5.2 Règles Générales de Cotation
Pour garantir la lisibilité et éviter les erreurs, la cotation doit suivre des règles strictes.
- Lignes de cote : Elles sont tracées en trait fin continu, parallèles à la dimension cotée. Elles doivent être placées à l’extérieur du dessin autant que possible et espacées régulièrement (entre 8 et 10 mm du dessin pour la première ligne).
- Éléments de la cote : La ligne de cote est terminée par des flèches à 45° ou des traits obliques. Les chiffres indiquant la mesure sont inscrits en caractères lisibles (hauteur 3 à 5 mm), au-dessus et au milieu de la ligne de cote.
- Types de cotes : Sur un plan, on distingue plusieurs lignes de cotes superposées :
- Cotes des trumeaux et des baies : La ligne la plus proche du dessin.
- Cotes d’implantation des murs : Distance entre les axes des murs et cloisons.
- Cotes des parties principales : Dimensions des grands ensembles.
- Cotes générales : Dimension totale de la façade ou du plan.
- Symboles spécifiques : Des symboles normalisés sont utilisés pour coter les rayons (R), les diamètres (Ø), les pentes (%) et les angles (°).
- Organisation : Une dimension ne doit être cotée qu’une seule fois, à l’endroit le plus utile pour la compréhension. Il faut éviter de surcharger les dessins et de croiser les lignes de cote. Les unités (généralement le mètre avec deux décimales en bâtiment) ne sont pas indiquées sur le dessin mais précisées dans le cartouche ou une note.
5.3 Dimensions Normalisées des Constructions
La coordination modulaire se traduit par la standardisation des dimensions des principaux composants du bâtiment.
| Portes et Baies (Dimensions nominales en cm) |
|
|
| Portes intérieures |
1 vantail : Largeurs 65, 75, 85, 95, 125, 145, 165 cm |
2 vantaux : Largeurs 120, 140, 160 cm |
|
Hauteurs standard : 200, 210, 220 cm |
|
| Portes extérieures |
1 vantail : Largeurs 95, 105, 135, 145, 155, 165 cm |
2 vantaux : Largeurs 140, 150, 160 cm |
|
Hauteurs standard : 210, 220, 230 cm |
|
| Escaliers (Caractéristiques des marches en cm) |
|
|
| Composition |
La formule de Blondel (60 < G + 2H < 64) lie le giron (G) à la hauteur de marche (H). |
|
| Marche normale |
Hauteur (H) : 16 à 17,5 cm |
Giron (G) : 27,5 à 29 cm |
| Largeur (emmarchement) |
Minimum 0,90 m |
|
| Garde-Corps (Hauteurs de protection selon NF P 01-012) |
|
| Hauteur minimale |
1,00 m (peut être abaissée à 0,90 m si l’épaisseur est > 0,50 m) |
| Vides verticaux |
Espacement maximal entre barreaux : 11 cm |
| Vides horizontaux |
Espacement maximal entre lisses : 18 cm (ou 5 cm en partie basse pour éviter l’escalade) |
5.4 Tolérances d’Exécution
Aucune construction n’est parfaite. Les tolérances définissent les écarts dimensionnels admissibles lors de l’exécution des ouvrages. Elles sont essentielles pour assurer l’assemblage correct des différents composants (gros œuvre, menuiseries, etc.).
| Objet |
Tolérance en mm |
Norme de référence |
| Implantation (après exécution ou mise en place) |
± 15 |
P 01-007 |
| Niveaux des étages |
± 10 |
P 01-007 |
| Épaisseur des murs, poteaux et planchers |
|
|
| - Pierre de taille |
± 1 à 0 |
P 01-007 |
| - Béton ou béton armé |
+ 10 à -5 |
P 01-007 |
| - Moellons appareillés |
± 5 |
P 01-007 |
| - Maçonnerie de moellons |
± 10 |
P 01-007 |
| Cloisons (sur l’implantation) |
± 15 |
P 01-007 |
| Cotes nominales des portes (hauteur/largeur) |
+0 à +5 |
P 10-402 |
| Cotes nominales des baies (hauteur/largeur) |
+5 à +10 |
P 10-401 |
| Escaliers (sur hauteur de marche finie) |
± 6 |
P 01-010 et P 01-011 |
5.5 Mesures-Types de l’Homme
La conception des espaces de vie et de travail doit tenir compte des dimensions et de l’encombrement du corps humain pour garantir le confort et la sécurité. Cette approche ergonomique, basée sur des mesures-types (ou « modulor »), influence directement le dimensionnement.
- Homme debout : Hauteur moyenne de 1,75 m, largeur aux coudes d’environ 90 cm.
- Homme assis : Hauteur d’assise de 0,45 m, hauteur de table de travail d’environ 0,72 m.
- Encombrement : Un passage confortable nécessite une largeur de 0,90 m. Un lit standard mesure 1,90 m de long.
Ces données sont fondamentales pour dimensionner correctement les couloirs, les escaliers, les plans de travail, les dégagements autour du mobilier et la hauteur des garde-corps.
Ces règles générales de représentation, de cotation et de dimensionnement forment un socle commun. Les chapitres suivants détailleront comment ces principes sont appliqués et complétés par des conventions spécifiques à chaque grand corps de métier du bâtiment.
6.0 Normes Spécifiques par Corps d’État
Si les principes généraux du dessin forment un langage universel pour tous les acteurs du bâtiment, chaque corps d’état a développé ses propres conventions, symboles et exigences de représentation. Ces normes spécifiques sont essentielles pour transmettre des informations techniques précises aux spécialistes chargés de l’exécution, qu’il s’agisse de couler une poutre en béton armé, de souder une charpente métallique ou d’installer un circuit électrique.
6.1 Béton Armé
- Dessins de Coffrage : Ces dessins représentent le « moule » dans lequel le béton sera coulé. Ils définissent les formes et les dimensions du gros œuvre.
- Repérage : Chaque élément est repéré de manière unique. Les poteaux sont identifiés par leur numéro (ex: P1, P2) et les poutres par des chiffres (ex: 101 pour une poutre du 1er étage). Les dalles sont repérées par des lettres minuscules cerclées.
- Cotation : Les cotes indiquent les dimensions « nues » des éléments (nus de poutre, nus de poteau), c’est-à-dire avant l’application des enduits.
- Représentation : Les parties vues sont en trait fort. Les coupes utilisent des traits très gros pour les parties coupées et des traits fins pour les parties non coupées. Les symétries sont indiquées par un trait mixte pour alléger le dessin.
- Dessins d’Armatures : Ces dessins, aussi appelés plans de ferraillage, détaillent la position, la forme et la quantité des aciers à l’intérieur du béton.
- Représentation des traits : Les armatures sont représentées en trait très gros. Le contour du béton est en trait moyen. La cotation et les lignes de rappel sont en trait fin. Pour différencier les lits d’armatures, on peut utiliser des traits continus, interrompus ou pointillés.
- Symboles de recouvrement :
- Recouvrement sans crochets : Représenté par deux barres rectilignes qui se chevauchent simplement en élévation.
- Recouvrement avec crochets : Les extrémités des barres sont représentées avec une courbure à 90° ou plus, conformément au symbole de la source.
- Repérage et Cotation : Une ligne de rappel indique la nature et la position des aciers. L’annotation est codifiée. Prenons l’exemple de la source :
52 Ø 6 x 4,00 (8 p. m.) porté par une ligne de rappel partant du repère 5.
5 : Repère de la barre (numéro de position).52 : Nombre total de barres de ce type.Ø 6 : Indique des barres de diamètre 6 mm.x 4,00 : Longueur de chaque barre = 4,00 m.(8 p. m.) : Répartition de 8 barres par mètre.
6.2 Serrurerie et Charpente Métallique
- Assemblages : La manière dont les pièces métalliques sont connectées est cruciale et doit être symbolisée de manière précise.
| Méthode d’Assemblage |
Symboles et Indications |
| Rivetage |
Le type de rivet (tête ronde, fraisée) est représenté par un symbole. Une croix indique un rivet posé à l’atelier, un cercle noirci un rivet posé sur chantier. |
| Soudage |
Un système de symboles complexes indique le type de soudure (en V, d’angle, sur bords relevés, etc.), sa position (sur ou sous la ligne de joint) et ses dimensions (longueur, épaisseur). |
| Boulonnerie |
La désignation spécifie le type de boulon (ex: Boulon H. 18.90/45) en indiquant le diamètre, la longueur et la classe de qualité. La représentation est schématique sur les vues d’ensemble. |
- Représentation des Profilés :
- Dessin d’ensemble : Les profilés sont souvent représentés schématiquement, sans montrer leur épaisseur réelle, pour ne pas surcharger le dessin. Seuls les contours extérieurs principaux sont visibles.
- Dessin de détail : À plus grande échelle (1/10, 1/5), les profilés sont dessinés avec leur forme et leur épaisseur exactes. Les parties coupées sont hachurées.
- Cotation : Les règles générales s’appliquent. Une cotation simplifiée est souvent utilisée sur les vues d’ensemble pour indiquer l’ordre de grandeur (longueur, largeur, hauteur).
6.3 Menuiserie et Charpente en Bois
- Charpentes :
- Charpente traditionnelle : Constituée de pièces de bois massives assemblées. Les dessins de détail sont nécessaires pour montrer les assemblages complexes (tenons, mortaises). Les symboles principaux sont :
- Ligne de trave : Ligne horizontale passant par le point le plus bas de la face supérieure des chevrons.
- Ligne d’axe : Ligne verticale indiquant l’axe principal de la ferme.
- Ligne d’épure : Ligne indiquant l’emplacement d’une pièce par rapport à la ligne du côté du signe.
- Charpente moderne (fermettes) : Constituée d’éléments plus fins assemblés par des connecteurs métalliques. Le dessin ne vise plus à représenter un dessin exact de l’ensemble mais une épure faisant apparaître clairement les cotes des nœuds et la longueur des barres.
- Menuiseries : La représentation des portes et fenêtres est hautement codifiée pour indiquer leur type et leur mode de fonctionnement (NF P. 02-012).
- Ouverture en poussant : Un trait continu indique l’ouvrant du côté intérieur. Un arc de cercle montre le débattement.
- Ouverture en tirant : Un trait interrompu indique l’ouvrant du côté intérieur.
- Coulissant : Une flèche parallèle au dormant indique le sens du coulissement.
- À soufflet : Le symbole indique un pivot en partie basse.
- Basculant : Le symbole indique un pivot horizontal au centre.
- Fenêtre à guillotine : Les flèches indiquent un mouvement vertical.
En élévation, un trait moyen est utilisé pour toutes les arêtes. En coupe, un trait fort est utilisé pour les pièces coupées, un trait moyen pour les arêtes vues en arrière-plan, et un trait fin pour les contours des pièces non coupées.
6.4 Sanitaire, Chauffage, Couverture
- Canalisations et Robinetterie : Les schémas de plomberie et de chauffage utilisent un grand nombre de symboles pour représenter le parcours des fluides et les équipements.
| Catégorie |
Exemples de Symboles |
| Canalisations |
Trait continu (vue), trait interrompu (cachée), trait mixte (en fourreau). |
| Vannes, Robinets |
Symboles spécifiques pour robinet à soupape, vanne, robinet tournant, mitigeur, etc. |
| Clapets |
Clapet d’arrêt, clapet de non-retour. |
| Pompes |
Symbole général, pompe volumétrique, pompe centrifuge. |
| Appareils |
Symboles |
| Générateurs |
Chaudière, générateur de vapeur, échangeur. |
| Réservoirs |
Réservoir sous pression, vase d’expansion. |
Fluides (Teintes et Abréviations Conventionnelles - NF d’après X 08-100)
Eau : Vert (E)
Vapeur d’eau : Gris argent (V)
Air : Bleu clair (A)
Gaz : Jaune orangé (G)
Huiles, Fuel-oils : Brun (FO)
Acides : Violet
- Couverture : Les dessins de couverture (plans, coupes, détails) montrent la forme des toitures, l’évacuation des eaux pluviales et les détails d’étanchéité.
- Cotation : Les plans sont cotés pour indiquer les dimensions des versants, la position des éléments (chéneaux, noues), et les pentes.
- Représentation : Des symboles spécifiques sont utilisés pour les chéneaux, les noues, les descentes d’eaux pluviales, les solins, et autres ouvrages d’étanchéité. Les matériaux de couverture (tuiles, ardoise, zinc) sont indiqués dans une légende ou directement sur le dessin.
6.5 Électricité
- Conducteurs et Câbles : La désignation d’un câble électrique est codifiée pour en décrire la composition. Par exemple, dans U 500 S C 1 N :
- U : Normalisé ou non.
- 500 : Tension de service (ici, 500 V).
- S : Nature de l’âme (S pour souple).
- C : Nature de l’enveloppe isolante (C pour caoutchouc vulcanisé).
- 1 : Gaine de bourrage.
- N : Revêtement métallique de protection.
- Symboles Graphiques : Les schémas électriques utilisent des symboles normalisés pour représenter chaque composant d’une installation.
| Fonction |
Exemples de Symboles |
| Conducteurs et Connexions |
Conducteur (trait), croisement sans raccord, dérivation. |
| Prises de courant |
Symbole de prise avec indication du nombre de pôles (ex: 2P+T). |
| Appareils d’interruption |
Interrupteur simple, va-et-vient, commutateur. |
| Appareils d’éclairage |
Point lumineux à incandescence (cercle avec croix), fluorescent. |
| Appareils de protection |
Coupe-circuit à fusible, disjoncteur. |
- Schémas et Plans d’Implantation :
- Schéma général de distribution : C’est un schéma unifilaire qui montre l’organisation générale des circuits depuis le tableau de distribution, en indiquant la nature des circuits et les protections associées.
- Plan d’implantation : C’est un plan d’architecte sur lequel sont superposés les symboles des appareils électriques (prises, interrupteurs, points lumineux) et le tracé des canalisations qui les relient. Des couleurs peuvent être utilisées pour différencier les circuits (ex: éclairage en vert, force motrice en orange).
La maîtrise de ces normes spécifiques à chaque métier est complétée par la capacité à utiliser des données techniques et mathématiques de référence pour effectuer les calculs et les vérifications nécessaires à la conception.
7.0 Annexes : Données Techniques et Mathématiques de Référence
Cette dernière section constitue une boîte à outils technique, un aide-mémoire indispensable regroupant les informations, tables et formules nécessaires aux calculs courants, aux vérifications dimensionnelles et à la compréhension des unités et symboles fondamentaux utilisés dans tous les domaines du bâtiment. Elle est la ressource de référence qui appuie la pratique quotidienne du dessinateur et du technicien.
7.1 Données Techniques sur les Matériaux
- Liants Hydrauliques et Aciers :
| Liants Hydrauliques (Norme AFNOR du 10.7.1967) |
|
| Dénomination |
Résistance (jours/etc.) |
| CPA, CPAC, CPAL |
Ciments Portland Artificiels |
| CLK, CLX |
Ciments de Laitier |
| CMF |
Ciments de Haut Fourneau |
| … |
… |
| Sections et Surfaces des Aciers pour Béton Armé (en mm²) |
|
| Diamètre (en mm) |
Section par barre |
| 5 |
19,6 |
| 6 |
28,3 |
| 8 |
50,3 |
| 10 |
78,5 |
| … |
… |
- Caractéristiques des Matériaux :
| Nom |
Symbole Chimique |
Densité |
Température de Fusion® |
| Aluminium |
Al |
2,7 |
658°C |
| Argent |
Ag |
10,53 |
960°C |
| Cuivre |
Cu |
8,90 |
1083°C |
| Etain |
Sn |
7,30 |
232°C |
| Fer |
Fe |
7,85 |
1530°C |
| Or |
Au |
19,25 |
1063°C |
| Platine |
Pt |
21,45 |
1770°C |
| Plomb |
Pb |
11,34 |
327°C |
| Zinc |
Zn |
7,13 |
419°C |
| Eau |
H2O |
1 |
0°C |
| … |
… |
… |
… |
7.2 Tables de Calculs
- Pentes et Rampes : Les tables de sécantes (Doc B.97 et B.98) permettent de déterminer rapidement la longueur d’une rampe ou d’un rampant de toiture en fonction de sa longueur projetée horizontalement et de son angle.
- Chéneaux et Conduits : Des abaques permettent de dimensionner les ouvrages d’évacuation des eaux.
- Chéneaux et gouttières (B.99) : La table donne la section (en cm²) d’un chéneau en fonction de la surface de toiture collectée (en m²) et de la pente du chéneau (en mm/m).
- Conduits de fumée (B.100) : L’abaque donne la section du conduit (en dm²) en fonction de la puissance thermique de l’appareil (en kcal/h) et du type de combustible (coke, anthracite, mazout).
7.3 Documentation Générale et Mathématique
| Système International (SI) |
|
| Grandeur |
Unité (Symbole) |
| Longueur |
Mètre (m) |
| Masse |
Kilogramme (kg) |
| Temps |
Seconde (s) |
| Intensité de courant |
Ampère (A) |
| Force |
Newton (N) |
| Pression |
Pascal ¶ |
| Symboles Mathématiques |
|
≠ |
Différent de |
≈ |
Égal environ à |
> |
Supérieur à |
√ |
Racine carrée |
⊥ |
Perpendiculaire à |
// |
Parallèle à |
- Tables Mathématiques : Le document de référence met à disposition une série de tables pour les calculs :
- Nombres premiers
- Logarithmes
- Carrés et racines carrées
- Tables trigonométriques (Sinus, Cosinus, Tangente, Cotangente)
- Formules Géométriques :
| Surfaces Planes |
Formule |
| Carré |
S = a² |
| Rectangle |
S = b.h |
| Triangle |
S = (b.h)/2 |
| Cercle |
S = π.R² |
| Ellipse |
S = π.a.b/4 |
| Volumes |
Formule |
| Cube |
V = a³ |
| Parallélépipède rectangle |
V = a.b.c |
| Cylindre |
V = π.R².h |
| Cône |
V = (π.R².h)/3 |
| Sphère |
V = (4/3).π.R³ |
- Centre de Gravité : Des schémas et formules permettent de localiser le centre de gravité (G) de formes simples :
- Lignes : Milieu d’un segment, point de concours des bissectrices pour un triangle.
- Surfaces : Point de rencontre des diagonales pour un parallélogramme, point de concours des médianes pour un triangle.
- Volumes : Hauteur OG = h/2 pour un prisme ou un cylindre, OG = h/4 pour une pyramide ou un cône.